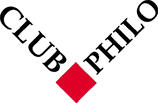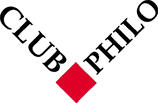|

Galerie de portraits
ll Dictionnaire du Club
Luc
Ferry,
Apprendre à vivre,
Traité de philosophie destiné aux jeunes générations |
|
|
Apprendre
à vivre, Traité de philosophie à l'usage
des jeunes générations
Plon,
2006, 302 pages.
«Je vais te raconter l'histoire de la philosophie. Pas
toute, bien sûr, mais quand même ses cinq plus
grands moments. Chaque fois, je te donnerai l'exemple d'une
ou deux grandes visions du monde liées à une
époque afin que tu puisses, si tu le souhaites, commencer
à lire par toi-même les oeuvres les plus importantes.
Je te fais, d'entrée de jeu, une promesse: toutes ces
pensées, je te les exposerai d'une façon totalement
claire, sans le moindre jargon, mais en allant à l'essentiel,
à ce qu'elles ont chaque fois de plus profond et deplus
passionnant. Si tu prends la peine de me suivre, tu sauras
donc vraiment en quoi consiste la philosophie, comment elle
éclaire de façon irremplaçable les multiples
interrogations qui portent sur la façon dont nous pourrions
ou devrions conduire nos existences» p. 15
Le Club de Philosophie remercie vivement les éditions
Plon
de lui avoir donné l'autorisation de reproduire en
ligne à titre gracieux les extraits ci-dessous. Droits
réservés.
Lire un autre extrait : Repenser
la question du salut : à quoi ser de grandir?,
pp. 276-292 (Format
PDF, 191 Ko) |
| CV
de Luc Ferry |
Lire un extrait, pp. 17-31, (Format
PDF, 188 Ko)
La finitude humaine et
la question du salut
« Je voudrais que tu comprennes bien ce mot - «
salut » - et que tu perçoives aussi comment
les religions tentent de prendre en charge les questions
qu'il soulève. Car le plus simple, pour commencer
à cerner ce qu'est la philosophie, c'est encore,
comme tu vas voir, de la situer par rapport au projet religieux.
Ouvre un dictionnaire et tu verras que le « salut
» désigne d'abord et avant tout « le
fait d'être sauvé, d'échapper à
un grand danger ou à un grand malheur ». Fort
bien. Mais à quelle catastrophe, à quel péril
effrayant les religions prétendent-elles nous faire
échapper? Tu connais déjà la réponse:
c'est de la mort, bien sûr, qu'il s'agit. Voilà
pourquoi elles vont toutes s'efforcer, sous des formes diverses,
de nous promettre la vie éternelle, pour nous assurer
que nous retrouverons un jour ceux que nous aimons - parents
ou amis, frères ou soeurs, maris ou femmes, enfants
ou petits-enfants, dont l'existence terrestre, inéluctablement,
va nous séparer.
Dans l'Evangile de Jean, Jésus lui-même fait
l'expérience de la mort d'un ami cher, Lazare. Comme
le premier être humain venu, il pleure. Tout simplement,
il fait l'expérience, comme toi et moi, du déchirement
lié à la séparation. Mais, à
la différence de nous autres, simples mortels, il
est en son pouvoir de ressusciter son ami. Et il le fait,
pour montrer, dit-il, que « l'amour est plus fort
que la mort ». Et c'est au fond ce message qui constitue
l'essentiel de la doctrine chrétienne du salut: la
mort, pour ceux qui aiment, pour ceux qui ont confiance
dans la parole du Christ, n'est qu'une apparence, un passage.
Par l'amour et par la foi, nous pouvons gagner l'immortalité.
Ce qui tombe bien, il faut l'avouer. Que désirons-nous,
en effet, par-dessus tout? Ne pas être seuls, être
compris, aimés, ne pas être séparés
de nos proches, bref, ne pas mourir et qu'ils ne meurent
pas non plus. Or l'existence réelle déçoit
un jour ou l'autre toutes ces attentes. C'est donc dans
la confiance en un Dieu que certains cherchent le salut
et les religions nous assurent qu'ils y parviendront.
Pourquoi pas, si l'on y croit et que l'on a la foi? Mais
pour ceux qui ne sont pas convaincus, pour ceux qui doutent
de la véracité de ces promesses, le problème,
bien entendu, reste entier. Et c'est là justement
que la philosophie prend, pour ainsi dire, le relais.
D'autant que la mort elle-même - le point est crucial
si tu veux comprendre le champ de la philosophie - n'est
pas une réalité aussi simple qu'on le croit
d'ordinaire. Elle ne se résume pas à la «
fin de la vie », à un arrêt plus ou moins
brutal de notre existence. Pour se rassurer, certains sages
de l'Antiquité disaient qu'il ne faut pas y penser
puisque, de deux choses l'une : ou bien je suis en vie,
et la mort, par définition, n'est pas présente,
ou bien elle est présente et, par définition
aussi, je ne suis plus là pour m'inquiéter!
Pourquoi, dans ces conditions, s'embarrasser d'un problème
inutile?
Le raisonnement, malheureusement, est un peu trop court
pour être honnête. Car la vérité,
c'est que la mort, à l'encontre de ce que suggère
l'adage ancien, possède bien des visages différents
dont la présence est paradoxalement
tout à fait perceptible au coeur même de la
vie la plus vivante.
Or c'est bien là ce qui, à un moment ou à
un autre, tourmente ce malheureux être fmi qu'est
l'homme puisque seul il a conscience que le temps lui est
compté, que l'irréparable n'est pas une illusion
et qu'il lui faut peut-être bien réfléchir
à ce qu'il doit faire de sa courte vie. Edgar Poe,
dans un de ses poèmes les plus fameux, incarne cette
idée de l'irréversibilité du cours
de l'existence dans un animal sinistre, un corbeau perché
sur le rebord d'une fenêtre, qui ne sait dire et répéter
qu'une seule formule : Never more - « plus
jamais ».
Poe veut dire par là que la mort désigne en
général tout ce qui appartient à l'ordre
du «jamais plus». Elle est, au sein même
de la vie, ce qui ne reviendra pas, ce qui relève
irréversiblement du, passé et que l'on n'a
aucune chance de retrouver un jour. Il peut s'agir des vacances
de l'enfance en des lieux et avec des amis qu'on quitte
sans retour, du divorce de ses parents, des maisons ou des
écoles qu'un déménagement nous oblige
à abandonner, et de mille autres choses encore :
même s'il ne s'agit pas toujours de la disparition
d'un être cher, tout ce qui est de l'ordre du «
plus jamais» appartient au registre de la mort.
Tu vois, en ce sens, combien elle est loin de se résumer
à la seule fin de la vie biologique. Nous en connaissons
une infinité d'incarnations au beau milieu de l'existence
elle-même et ces visages multiples finissent par nous
tourmenter, parfois même sans que nous en ayons tout
à fait conscience. Pour bien vivre, pour vivre libre,
capable de joie, de générosité et d'amour,
il nous faut d'abord et avant tout vaincre la peur - ou,
pour mieux dire, «les» peurs, tant les manifestations
de l'Irréversible sont diverses.
Mais c'est là, justement, que religion et philosophie
divergent fondamentalement.
Philosophie et religion : deux façons
opposées d'approcher la question du salut
Face à la menace suprême qu'elles prétendent
nous permettre de surmonter, comment opèrent, en
effet, les religions? Pour l'essentiel, par la foi. C'est
elle, et elle seule en vérité, qui peut faire
retomber sur nous la grâce de Dieu : si tu as foi
en Lui, Dieu te sauvera, disent-elles, en quoi elles requièrent
avant toute autre vertu l'humilité qui s'oppose
à leurs yeux - c'est ce que ne cessent de répéter
les plus grands penseurs chrétiens, de saint Augustin
à Pascal - à l'arrogance et à la vanité
de la philosophie. Pourquoi cette accusation lancée
contre la libre pensée? Tout simplement parce que
cette dernière prétend bien, elle aussi, nous
sauver sinon de la mort elle-même, du moins des angoisses
qu'elle inspire, mais par nos propres forces et en vertu
de notre seule raison. Voilà, du moins d'un
point de vue religieux, l'orgueil philosophique par excellence,
l'audace insupportable déjà perceptible chez
les premiers philosophes, dès l'Antiquité
grecque, plusieurs siècles avant Jésus-Christ.
Et c'est vrai. Faute de parvenir à croire en un Dieu
sauveur, le philosophe est d'abord celui qui pense qu'en
connaissant le monde, en se comprenant soi-même et
en comprenant les autres autant que nous le permet notre
intelligence, nous allons parvenir, dans la lucidité
plutôt que dans une foi aveugle, à surmonter
nos peurs.
En d'autres termes, si les religions se définissent
elles-mêmes comme des «doctrines du salut»
par un Autre, grâce à Dieu, on pourrait définir
les grandes philosophies comme des doctrines du salut par
soi-même, sans l'aide de Dieu.
C'est ainsi qu'Epicure, par exemple, définit la philosophie
comme une « médecine de l'âme »
(1) dont l'objectif ultime est de nous faire comprendre
que « la mort n'est pas à redouter ».
C'est là encore tout le programme philosophique que
son plus éminent disciple, Lucrèce, expose
dans son poème intitulé De la nature des
choses :
« Il faut avant tout chasser .et détruire cette
crainte de l'Achéron [le fleuve des Enfers] qui,
pénétrant jusqu'au fond de notre être,
empoisonne la vie humaine, colore toute chose de la noirceur
de la mort et ne laisse subsister aucun plaisir limpide
et pur.»
Mais c'est tout aussi vrai pour Epictète, l'un des
plus grands représentants d'une autre école
philosophique de la Grèce ancienne dont je te parlerai
dans un instant, le stoïcisme, qui va même jusqu'à
réduire toutes les interrogations
philosophiques à une seule et même source :
la crainte de la mort.
Ecoutons-le un instant s'adresser à son disciple
au fil des entretiens qu'il échange avec lui :
« As-tu bien dans l'esprit, lui dit-il, que le
principe de tous les maux pour l'homme, de la bassesse,
de la lâcheté, c'est... la crainte de la mort?
Exerce-toi contre elle; qu'à cela tendent toutes
tes paroles, toutes tes études, toutes tes lectures
et tu sauras que c'est le seul moyen pour les hommes de
devenir libres » (2).
On retrouve encore ce même thème chez Montaigne,
dans son fameux adage selon lequel «philosopher c'est
apprendre à mourir », mais aussi chez Spinoza,
avec sa belle réflexion sur le sage qui «meurt
moins que le fou », chez Kant, lorsqu'il se demande
« ce qu'il nous est permis d'espérer »,
et même chez Nietzsche, qui retrouve, avec sa pensée
de «l'innocence du devenir », les éléments
les plus profonds des doctrines du salut forgées
dans l'Antiquité. Ne t'inquiète pas si ces
allusions aux grands auteurs ne te disent encore rien. C'est
normal puisque tu commences. Nous allons revenir à
chacun de ces exemples pour les clarifier et les expliciter.
Ce qui importe seulement, pour l'instant, c'est que tu comprennes
pourquoi, aux yeux de tous ces philosophes, la crainte de
la mort nous empêche de bien vivre. Pas seulement
parce qu’elle génère de l'angoisse.
À vrai dire, la plupart du temps, nous n'y pensons
pas - et je suis sûr que tu ne passes pas tes journées
à méditer le fait que les hommes sont mortels!
Mais, bien plus profondément, parce que l'irréversibilité
du cours des choses, qui est une forme de mort au coeur
même de la vie, mena.ce toujours de nous entraîner
dans une dimension du temps qui corrompt l'existence : celle
du passé où viennent se loger ces grands corrupteurs
de bonheur que sont la nostalgie et la culpabilité,
le regret et le remords.
Tu me diras peut-être qu'il suffit de ne plus y penser,
d'essayer, par exemple, de s'en tenir aux souvenirs les
plus heureux plutôt que de ressasser les mauvais moments.
Mais paradoxalement, la mémoire des instants de bonheur
peut tout aussi bien nous tirer insidieusement hors du réel.
Car elle les transforme avec le temps en des «paradis
perdus» qui nous attirent insensiblement vers le passé
et nous interdisent ainsi de goûter le présent.
Comme tu le verras dans ce qui suit, les philosophes grecs
pensaient que le passé et le futur sont les deux
maux qui pèsent sur la vie humaine, les deux foyers
de toutes les angoisses qui viennent gâter la seule
et unique dimension de l'existence qui vaille d'être
vécue - tout simplement parce qu'elle est la seule
réelle: celle de l'instant présent. Le passé
n'est plus et le futur n'est pas encore se plaisaient-ils
à souligner, et pourtant, nous vivons presque toute
notre vie entre souvenirs et projets, entre nostalgie et
espérance. Nous nous imaginons que nous serions beaucoup
plus heureux si nous avions enfin ceci ou cela, de nouvelles
chaussures ou un ordinateur plus performant, une autre maison,
d'autres vacances, d'autres amis... Mais à force
de regretter le passé ou d'espérer en l'avenir,
nous en finissons par manquer la seule vie qui vaille d'être
vécue, celle qui relève de l'ici et du maintenant
et que nous ne savons pas aimer comme elle le mériterait
sûrement.
Face à ces mirages qui corrompent le goût de
vivre, que nous promettent les religions?
Que nous n'avons plus à avoir peur, puisque nos principales
attentes seront comblées et qu'il nous est possible
de vivre le présent tel qu'il est... en attendant
quand même un avenir meilleur! Il existe un Etre infini
et bon qui nous aime par-dessus tout. Nous serons ainsi
sauvés par lui de la solitude, de la séparation
d'avec des êtres chers qui, même s'ils disparaissent
un jour en cette vie, nous attendrons dans une autre.
Que faut-il faire pour être ainsi «sauvé»?
Pour l'essentiel, il suffit de croire. C'est en effet dans
la foi que l'alchimie doit s'opérer et par la grâce
de Dieu. Face à Celui qu'elles tiennent pour l'Etre
suprême, Celui dont tout dépend, elles nous
invitent à une attitude qui tient tout entière
en deux mots : confiance - en latin le mot se dit fides
qui veut également dire « foi» - et humilité.
C'est en quoi aussi la philosophie, qui emprunte un chemin
contraire, confine au diabolique.
La théologie chrétienne a développé
dans cette optique une réflexion profonde sur les
«tentations du diable ». Le démon, contrairement
à l'imagerie populaire souvent véhiculée
par une Eglise en mal d'autorité, n'est pas celui
qui nous écarte, sur le plan moral, du droit chemin
en faisant appel à la faiblesse de la chair. C'est
celui qui, sur le plan spirituel, fait tout son possible
pour nous séparer (dia-bolos veut
dire en grec « celui qui sépare») du
lien vertical qui relie les vrais croyants à Dieu
et qui seul les sauve de la désolation et de la mort.
Le Diabolos ne se contente pas d'opposer les hommes
entre eux, en les poussant par exemple à se haïr
et à se faire la guerre, mais beaucoup plus grave,
il coupe l'homme de Dieu et le livre ainsi à toutes
les angoisses que la foi avait réussi à guérir.
Pour un théologien dogmatique, la philosophie - sauf,
bien entendu, si elle est soumise de part en part à
la religion et mise tout entière à son service
(mais alors, elle n'est plus vraiment philosophie...) -
est par excellence l'oeuvre du diable, car en incitant l'homme
à se détourner . des croyances pour faire
usage de sa raison, de son esprit critique, elle l'entraîne
insensiblement vers le terrain du doute, qui est
le premier pas hors de la tutelle divine.
Au début de la Bible, dans le récit de la
Genèse, c'est, comme tu t'en souviens peut-être,
le serpent qui joue le rôle du Malin quand il pousse
Adam et Eve à douter du bien-fondé
des commandements divins interdisant de toucher au fruit
défendu. Si le serpent veut que les deux premiers
humains s' interrogent et croquent la pomme, c'est afin
qu'ils désobéissent à Dieu, parce que
en les séparant de Lui, il sait qu'il va pouvoir
leur infliger tous les tourments inhérents à
la vie des simples mortels. C'est avec la « chute
», la sortie du paradis premier - où nos deux
humains vivaient heureux, sans peur aucune, en harmonie
avec la nature comme avec Dieu -, que les premières
formes d'angoisse apparaissent. Toutes sont liées
au fait qu'avec la chute, elle-même directement issue
du doute quant à la pertinence des interdits divins,
les hommes sont devenus mortels.
La philosophie - toutes les philosophies, si divergentes
soient-elles parfois dans les réponses qu'elles tentent
d'apporter - nous promet aussi d'échapper à
ces peurs primitives. Elle a donc, au moins à l'origine,
en commun avec les religions la conviction que l'angoisse
empêche de vivre bien: elle nous interdit non seulement
d'être heureux, mais aussi d'être libres. C'est
là, comme je te l'ai déjà suggéré
par quelques exemples, un thème omniprésent
chez les premiers philosophes grecs: on ne peut ni penser
ni agir librement quand on est paralysé par la sourde
inquiétude que génère, même lorsqu'elle
. est devenue inconsciente, la crainte de l'irréversible.
Il s'agit donc d'inviter les humains à se «
sauver ».
Mais, comme tu l'as maintenant compris, ce salut doit venir
non d'un Autre, d'un Etre «transcendant»
(ce qui veut dire « extérieur et supérieur»
à nous), mais bel et bien de nous-mêmes.
La philosophie veut que nous nous tirions d'affaire par
nos propres forces, par les voies de la simple raison, si
du moins nous parvenons à l'utiliser comme il faut,
avec audace et fermeté. Et c'est cela, bien sûr,
que veut dire Montaigne quand, faisant lui aussi allusion
à la sagesse des anciens philosophes grecs, il nous
assure que «philosopher, c'est apprendre à
mourir ».
Toute philosophie est-elle donc vouée à être
athée? Ne peut-il y avoir une philosophie chrétienne,
juive, musulmane? Et si oui, en quel sens? Inversement,
quel statut accorder aux grands philosophes qui, comme Descartes
ou comme Kant, furent croyants? Et pourquoi d'ailleurs,
me diras-tu peut-être, refuser la promesse des religions?
Pourquoi ne pas accepter avec humilité de se soumettre
aux lois d'une doctrine du salut « avec Dieu»
?
Pour deux raisons majeures, qui sont sans doute à
l'origine de toute philosophie.
D'abord - et avant tout - parce que la promesse que nous
font les religions pour calmer les angoisses de mort, à
savoir celle d'après laquelle nous sommes immortels
et allons retrouver après la mort biologique ceux
que nous aimons, est, comme on dit, trop belle pour être
vraie. Trop belle aussi, et tout aussi peu crédible,
l'image d'un Dieu qui serait comme un père avec ses
enfants. Comment la concilier avec l'insupportable répétition
des massacres et des malheurs qui accablent l'humanité
: quel père laisserait ses enfants dans l'enfer d'Auschwitz,
du Rwanda, du Cambodge? Un croyant dira sans doute que c'est
là le prix de la liberté, que Dieu a fait
les hommes libres et que le mal doit leur être imputé.
Mais que dire des innocents? Que dire des milliers de petits
enfants martyrisés au cours de ces ignobles crimes
contre l'humanité? Un philosophe finit par douter
que les réponses religieuses suffisent (3). Il finit
toujours plus ou moins par penser que la croyance en Dieu,
qui vient comme par contrecoup, en guise de consolation,
nous fait peut-être bien perdre davantage en lucidité
qu'elle ne nous fait gagner en sérénité.
Il respecte les croyants, bien entendu. Il ne prétend
pas nécessairement qu'ils ont tort, que leur foi
est absurde, encore moins que 'l'inexistence de Dieu est
certaine. Comment, d'ailleurs, pourrait-on prouver que Dieu
n'existe pas? Simplement, il n'a pas la foi, un point c'est
tout, et dans ces conditions, il lui faut chercher ailleurs,
penser autrement.
Mais il y a plus. Le bien-être n'est pas le seul
idéal sur Terre. La liberté, aussi, en est
un. Et si la religion calme les angoisses en faisant de
la mort une illusion, elle risque de le faire au prix de
la liberté de pensée. Car elle exige toujours
plus ou moins, en contrepartie de la sérénité
qu'elle prétend procurer, qu'à un moment ou
à un autre on abandonne la raison pour faire place
à la foi, qu'on mette un terme à l'esprit
critique pour accepter de croire. Elle veut que nous soyons,
face à Dieu, comme des petits enfants, non des adultes
en qui elle ne voit, finalement, que d'arrogants raisonneurs.
Philosopher plutôt que croire, c'est au fond - du
moins du point de vue des philosophes, celui des croyants
étant bien entendu différent - préférer
la lucidité au confort, la liberté à
la foi. Il s'agit bien en un sens, c'est vrai, de «
sauver sa peau », mais pas à n'importe quel
prix.
Dans ces conditions, me diras-tu peut-être, si la
philosophie est pour l'essentiel une quête de la vie
bonne hors religion, une recherche du salut sans Dieu,
d'où vient qu'on la présente si volontiers
dans les manuels comme un art de bien penser, de développer
l'esprit critique, la réflexion et l'autonomie individuelle?
D'où vient que, dans la cité, à la
télévision ou dans la presse, on la réduise
si souvent à un engagement moral qui oppose, dans
le cours du monde tel qu'il va, le juste et l'injuste? Le
philosophe n'est-t-il pas par excellence celui qui comprend
ce qui est, puis s'engage et s'indigne contre les maux du
temps? Quelle place accorder à ces autres dimensions
de la vie intellectuelle et morale? Comment les concilier
avec la définition de la philosophie que je viens
d'esquisser?
Les trois dimensions de la philosophie :
l'intelligence de ce qui est (théorie), la soif de
justice (éthique) et la quête du salut (sagesse)
Bien évidemment, même si la quête du
salut sans Dieu est bien au creur de toute grande philosophie,
si c'est là son objectif essentiel et ultime, il
ne saurait s'accomplir sans passer par une réflexion
approfondie sur l'intelligence de ce qui est - ce qu'on
nomme d'ordinaire la « théorie» - comme
sur ce qui devrait être ou qu'il faudrait faire -
ce qu'on désigne habitueIlement sous le nom de morale
ou d'éthique (4).
La raison en est d'ailleurs assez simple à comprendre.
Si la philosophie, comme les religions, trouve sa source
la plus profonde dans une réflexion sur la «
finitude» humaine, sur le fait qu'à nous autres
mortels, en effet, le temps est compté et que nous
sommes les seuls êtres dans ce monde à en avoir
pleinement conscience, alors il va de soi que la question
de savoir ce que nous allons faire de cette durée
limitée ne peut être éludée.
A la différence des arbres, des huîtres ou
des lapins, nous ne cessons de nous interroger sur notre
rapport au temps, sur ce à quoi nous allons l'occuper
ou l'employer - que ce soit d'ailleurs pour une période
brève, l'heure ou l'après-midi qui vient:
ou longue, le mois ou l'année en cours. Inévitablement,
nous en venons, parfois à l'occasion d'une rupture,
d'un événement brutal, à nous interroger
sur ce que nous faisons, pourrions ou devrions faire de
notre vie tout entière.
En d'autres termes l'équation« mortalité
+ conscience d'être mortel» est un cocktail
qui contient comme en germe la source de toutes les interrogations
philosophiques. Le philosophe est d'abord celui qui pense
que nous ne sommes pas là « en touristes »,
pour nous divertir. Ou pour mieux dire, même s'il
devait parvenir, au contraire de ce que je viens d'affirmer,
à la conclusion que seul le divertissement vaut la
peine d'être vécu, du moins serait-ce là
le résultat d'une pensée, d'une réflexion
et non d'un réflexe. Ce qui suppose que l'on parcourt
trois étapes: celle de la théorie,
celle de la morale ou de l'éthique,
puis celle de la conquête du salut ou de
la sagesse.
On pourrait formuler les choses simplement de la façon
suivante: la première tâche de la philosophie,
celle de la théorie, consiste à se faire une
idée du « terrain de jeu », à
acquérir un minimum de connaissance du monde dans
lequel notre existence va se dérouler. A quoi ressemble-t-il,
est-il hostile ou amical, dangereux ou utile, harmonieux
ou chaotique, mystérieux ou compréhensible,
beau ou laid? Si la philosophie est quête du salut,
réflexion sur le temps qui passe et qui est limité,
elle ne peut pas ne pas commencer par s' interroger sur
la nature de ce monde qui nous entoure. Toute philosophie
digne de ce nom part donc des sciences naturelles qui nous
dévoilent la structure de l'univers - la physique,
les mathématiques, la biologie, etc. - mais aussi
des sciences historiques qui nous éclairent sur son
histoire comme sur celle des hommes. «Nul n'entre
ici s'il n'est géomètre », disait Platon
à ses élèves en parlant de son école,
l'Académie, et à sa suite aucune philosophie
n'a jamais prétendu sérieusement faire l'économie
des connaissances scientifiques. Mais il lui faut aller
plus loin et s'interroger aussi sur les moyens
dont nous disposons pour connaître. Elle tente donc,
au-delà des considérations empruntées
aux sciences positives, de cerner la nature de la connaissance
en tant que telle, de comprendre les méthodes auxquelles
elle recourt (par exemple: comment découvrir les
causes d'un phénomène ?) mais aussi les limites
qui sont les siennes (par exemple: peut-on démontrer,
oui ou non, l'existence de Dieu ?).
Ces deux questions, celle de la nature du monde, celle des
instruments de connaissance dont disposent les humains,
constituent ainsi l'essentiel de la partie théorique
de la philosophie.
Mais il va de soi qu'en plus du terrain de jeu, qu'en plus
de la connaissance du monde et de l'histoire dans laquelle
notre existence va prendre place, il nous faut aussi nous
intéresser aux autres humains, à ceux avec
lesquels nous allons jouer. Car non seulement nous ne sommes
pas seuls, mais le simple fait de l'éducation montre
que nous ne pourrions tout simplement pas naître et
subsister sans l'aide d'autres humains, à commencer
par nos parents. Comment vivre avec autrui, quelles règles
du jeu adopter, comment nous comporter de manière
«vivable », utile, digne, de manière
tout simplement «juste» dans nos relations aux
autres? C'est toute la question de la deuxième partie
de la philosophie, la partie non plus théorique,
mais pratique, celle qui relève,
au sens large, de la sphère éthique.
Mais pourquoi s'efforcer de connaître le monde et
son histoire, pourquoi s'efforcer même de vivre en
harmonie avec les autres? Quelle est la finalité
ou le sens de tous ces efforts? Faut-il d'ailleurs que cela
ait un sens? Toutes ces questions, et quelques autres du
même ordre, nous renvoient à la troisième
sphère de la philosophie, celle qui touche, tu l'as
compris, à la question ultime du salut
ou de la sagesse. Si la philosophie,
selon son étymologie, est« amour» (philo)
de la sagesse (sophia), c'est en ce point qu'elle
doit s'abolir pour faire place, autant qu'il est possible,
à la sagesse elle-même, qui se passe bien 'sûr
de toute philosophie. Car être sage, par définition,
ce n'est pas aimer ou chercher à l'être, c'est,
tout simplement, vivre sagement, heureux et libre autant
qu'il est possible, en ayant enfin vaincu les peurs que
la finitude a éveillées en nous.
Mais tout cela devient bien trop abstrait, j'en ai conscience
et il ne sert à rien de continuer à explorer
la définition de la philosophie sans en donner maintenant
un exemple concret. Il te permettra de voir à l'oeuvre
les trois dimensions - théorie, éthique, quête
du salut ou sagesse - que nous venons d'évoquer.
Alors le mieux, c'est d'entrer sans plus tarder dans le
vif du sujet, de commencer par le commencement en remontant
aux origines, aux écoles de philosophie qui fleurissaient
dans l'Antiquité. Je te propose de considérer
le cas de la première grande tradition de pensée:
celle qui passe par Platon et Aristote puis trouve son expression
la plus achevée, ou à tout le moins la plus
« populaire », dans le stoïcisme. C'est
donc par lui que nous allons débuter. Ensuite, nous
pourrons continuer à explorer ensemble les plus grandes
époques de la philosophie. Il nous faudra aussi comprendre
pourquoi et comment on passe d'une vision du monde à
une autre. Est-ce parce que la réponse qui précède
ne nous suffit pas, parce qu'elle ne nous convainc plus,
parce qu'une autre l'emporte sans contestation, parce qu'il
existe en soi plusieurs réponses possibles?
Tu comprendras alors en quoi la philosophie est, contrairement,
là encore, à une opinion courante et faussement
subtile, bien davantage l'art des réponses que celui
des questions. Et comme tu vas pouvoir en juger par
toi-même - autre promesse cruciale de la philosophie,
justement parce qu'elle n'est pas religieuse et ne fait
pas dépendre la vérité d'un Autre -
tu vas bientôt percevoir combien ces réponses
sont profondes, passionnantes, et pour tout dire géniales.
»
Notes
(1) Il propose dans cette optique quatre remèdes
aux maux directement liés au fait que nous sommes
mortels: « Les dieux ne sont pas à craindre,
la mort n'est pas à redouter, le bien facile à
acquérir, le mal facile à supporter. »
(2) Voir le recueil intitulé Les Stoïciens,
Paris, Gallimard, La Pléiade, p. 1039.
(3) On objectera que cette argumentation ne vaut que contre
les visions populaires de la religion. Sans doute. Elles
n'en sont pas moins les plus nombreuses et les plus puissantes
en ce sens.
(4) Une remarque de vocabulaire, pour éviter des
malentendus. Faut-il dire « morale» ou «
éthique» et quelle différence y a-t-il
au juste entre ces deux termes? Réponse simple et
claire : a priori, aucune, et tu peux les utiliser
indifféremment. Le mot « morale » vient
du mot latin qui signifie « moeurs » et le mot
« éthique» du mot grec qui signifie,
lui aussi, «moeurs ». Ils sont donc parfaitement
synonymes et ne se distinguent que par leur langue d'origine.
Cela dit, certains philosophes ont profité du fait
que l'on avait deux termes pour leur donner des sens différents.
Chez Kant, par exemple, la morale désigne l'ensemble
des principes généraux et l'éthique
leur application concrète. D'autres philosophes encore
s'accorderont pour désigner par « morale »
la théorie des devoirs envers autrui, et par «
éthique » la doctrine du salut et de la sagesse.
Pourquoi pas? Rien n'interdit d'utiliser ces deux mots pour
leur donner des sens différents. Mais rien n'oblige
non plus à le faire et, sauf précision contraire,
j'utiliserai ces deux termes comme des synonymes parfaits
dans la suite de ce livre.
Luc Ferry,
Apprendre à vivre, Traité de philosophie
destiné aux jeunes générations,
Éditions Plon,
2006, pp. 17-31
|
|
|
|
|
|