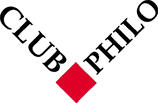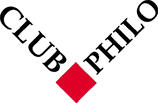Lire un extrait, pp. 276-292
(Format
PDF, 191 Ko)
III. REPENSER LA QUESTION DU
SALUT : À QUOI SERT DE GRANDIR?
Je voudrais, pour finir, te proposer trois éléments
de réflexion sur la façon dont un humanisme
non métaphysique peut aujourd'hui réinvestir
l'ancienne problématique de la sagesse : ils concernent
l'exigence de la pensée élargie,
la sagesse de l'amour et l'expérience
du deuil.
L'exigence de la pensée élargie
La « pensée élargie », d'abord.
Cette notion, que j'ai eu l'occasion d'évoquer à
la fin du chapitre sur la philosophie moderne, prend une
signification nouvelle dans le cadre de la pensée
post-nietzschéenne. Elle ne désigne plus simplement,
comme chez Kant, une exigence de l'esprit critique, une
contrainte argumentative (« se mettre à la
place des autres pour mieux comprendre leur point de vue
») mais, bel et bien, une nouvelle façon de
répondre à la question du sens de la vie.
Je voudrais t'en dire un mot afin de t'indiquer quelques-uns
des rapports qu'elle entretient avec la problématique
du salut ou, tout au moins, avec ce qui en tient désormais
lieu dans la perspective d'un humanisme post-nietzschéen,
débarrassé des idoles de la métaphysique.
Par opposition à l'esprit «borné »,
la pensée élargie pourrait se définir,
dans un premier temps, comme celle qui parvient à
s'arracher à soi pour se «mettre à la
place d'autrui », non seulement pour mieux le comprendre,
mais aussi pour tenter, en un mouvement de retour à
soi, de regarder ses propres jugements du point de vue qui
pourrait être celui des autres.
C'est là ce qu'exige l'autoréflexion dont
nous avons parlé tout à l'heure: pour prendre
conscience de soi, il faut bien se situer en quelque façon
à distance de soi-même. Là
où l'esprit borné reste englué dans
sa communauté d'origine au point de juger qu'elle
est la seule possible ou, à tout le moins, la seule
bonne et légitime, l'esprit élargi parvient,
en se plaçant autant qu'il est possible du point
de vue d'autrui, à contempler le monde en spectateur
intéressé et bienveillant. Acceptant de décentrer
sa perspective initiale, de s'arracher au cercle limité
de l'égocentrisme, il peut pénétrer
les coutumes et les valeurs éloignées des
siennes, puis, en revenant en lui-même, prendre conscience
de soi d'une manière distanciée, moins dogmatique,
et enrichir ainsi ses propres vues.
C'est aussi en quoi, j'aimerais que tu le notes au passage
et que tu mesures la profondeur des racines intellectuelles
de l'humanisme, la notion de «pensée élargie
» prolonge celle de «perfectibilité»
dont nous avons vu comment Rousseau voyait en elle le propre
de l'humain, par opposition à l'animal. Toutes deux
supposent, en effet, l'idée de liberté entendue
comme la faculté de s'arracher à sa condition
particulière pour accéder à plus d'universalité,
pour entrer dans une histoire individuelle ou collective
- celle de l'éducation d'un côté, de
la culture et de la politique de l'autre - au cours de laquelle
s'effectue ce que l'on pourrait nommer l'humanisation de
l'humain.
Or c'est aussi ce processus d'humanisation qui donne tout
son sens à la vie et qui, dans l'acception quasi
théologique du terme, la «justifie» dans
la perspective de l'humanisme. J'aimerais t'expliquer aussi
clairement que possible pourquoi.
Dans mon livre Qu'est-ce qu'une vie réussie?,
j'avais longuement cité un discours prononcé
à l'occasion de la remise de son prix Nobel de littérature,
en décembre 2001, par le grand écrivain anglo-indien
V. S. Naipaul. Il me semblait, en effet, décrire
à merveille cette expérience de la pensée
élargie et les bienfaits qu'elle peut apporter, non
seulement dans l'écriture d'un roman, mais plus profondément
dans la conduite d'une vie humaine. Je voudrais y revenir
un instant encore avec toi.
Dans ce texte, Naipaul raconte son enfance dans l'île
de Trinidad et il évoque les limitations inhérentes
à cette vie des petites communautés, refermées
sur elles-mêmes et repliées sur leurs particularismes,
en des termes auxquels j'aimerais que tu réfléchisses
:
« Nous autres Indiens, immigrés de l'Inde [...]
nous menions pour l'essentiel des vies ritualisées
et n'étions pas encore capables de l'autoévaluation
nécessaire pour commencer à apprendre. [...]
À Trinidad, où, nouveaux arrivants, nous formions
une communauté désavantagée, cette
idée d'exclusion était une sorte de protection
qui nous permettait, pour un moment seulement, de vivre
à notre manière et selon nos propres règles,
de vivre dans notre propre Inde en train de s'effacer. D’où
un extraordinaire égocentrisme. Nous regardions vers
l'intérieur; nous accomplissions nos journées;
le monde extérieur existait dans une sorte d'obscurité;
nous ne nous interrogions sur rien...»
Et Naipaul explique comment, une fois devenu écrivain,
«ces zones de ténèbres» qui l'environnaient
enfant - c'est-à-dire tout ce qui était présent
plus ou moins sur l'île mais que le repli sur soi
empêchait de voir : les aborigènes, le Nouveau
Monde, l'Inde, l'univers musulman, l'Afrique, l'Angleterre
- sont devenues les sujets de prédilection qui lui
permirent, prenant quelque distance, d'écrire un
jour un livre sur son île natale. Tu comprends déjà
que tout son itinéraire d'homme et d'écrivain
-les deux sont ici inséparables a consisté
à élargir l'horizon en faisant un gigantesque
effort de «décentration », d'arrachement
à soi en vue de parvenir à s'approprier les
fameuses «zones d'ombre» en question.
Puis il ajoute ceci, qui est peut-être l'essentiel
:
« Mais quand ce livre a été terminé,
j'ai eu le sentiment que j'avais tiré tout ce que
je pouvais de mon île. J'avais beau réfléchir,
aucune autre histoire ne me venait. Le hasard est alors
venu à mon secours. Je suis devenu voyageur. J'ai
voyagé aux Antilles et j'ai bien mieux compris le
mécanisme colonial dont j'avais fait partie. Je suis
allé en Inde, la patrie de mes ancêtres, pendant
un an ; ce voyage a brisé ma vie en deux. Les livres
que j'ai écrits sur ces deux voyages m'ont hissé
vers de nouveaux domaines d'émotion, m'ont donné
une vision du monde que je n'avais jamais eue, m'ont élargi
techniquement.»
Point de reniement, ici, ni de renonciation aux particularités
d'origine. Seulement une distanciation, un élargissement
(et il est tout à fait significatif que Naipaul utilise
lui-même le terme) qui permet de les saisir d'une
autre perspective, moins immergée, moins égocentrique
- par où l'oeuvre de Naipaul, loin d'en rester, comme
l'artisanat local, au seul registre du folklore, a pu s'élever
jusqu'au rang de la «littérature mondiale».
Je veux dire par là qu'elle n'est pas réservée
au public des «indigènes » de Trinidad,
ni même à celui des anciens colonisés,
parce que l'itinéraire qu'elle décrit n'est
pas seulement particulier: il possède une signification
humaine universelle qui, par-delà la particularité
de la trajectoire, peut toucher et faire réfléchir
tous les êtres humains.
Au plus profond, l'idéal littéraire, mais
aussi existentiel, que dessine ici Naipaul signifie qu'il
nous faut nous arracher à l'égocentrisme.
Nous avons besoin des autres pour nous comprendre nous-mêmes,
besoin de leur liberté et, si possible de leur bonheur,
pour accomplir notre propre vie. En quoi la considération
de la morale fait signe, pour ainsi dire d'elle-même,
vers une problématique plus haute : celle du sens.
Dans la Bible, connaître veut dire aimer. Pour dire
les choses un peu brutalement : quand on dit de quelqu'un
« il la connut bibliquement », cela signifie
« il a fait l'amour avec elle ». La problématique
du sens est une sécularisation de cette équivalence
biblique: si connaître et aimer sont une seule et
même chose, alors, ce qui par-dessus tout donne un
sens à nos vies, tout à la fois une orientation
et une signification, c'est bien l'idéal de la pensée
élargie. Lui seul, en effet, nous permet, en nous
invitant, dans tous les sens du terme, au voyage, en nous
exhortant à sortir de nous-mêmes pour mieux
nous retrouver - c'est là ce que Hegel nommait l'«expérience»
- de mieux connaître et de mieux aimer les autres.
À quoi sert de vieillir? À cela et peut-être
à rien d'autre. À élargir la vue, apprendre
à aimer la singularité des êtres comme
celle des oeuvres, et vivre parfois, lorsque cet amour est
intense, l'abolissement du temps que nous donne sa présence.
En quoi nous parvenons, mais seulement par moments, comme
nous y invitaient les Grecs, à nous affranchir de
la tyrannie du passé et de l'avenir pour habiter
ce présent enfin déculpabilisé et serein
dont tu as maintenant compris qu'il était alors comme
un «moment d'éternité », comme
un instant où la crainte de la mort n'est enfin plus
rien pour nous.
C'est en ce point que la question du sens et celle du salut
se rejoignent.
Mais Je ne veux pas en rester là, car ces formules,
qui annoncent une pensée, sont encore très
insuffisantes pour te la faire comprendre. Il nous faut
aller plus loin et tâcher de saisir en quoi il existe
bel et bien une « sagesse de l'amour », une
vision de l'amour qui permet de saisir pleinement les raisons
pour lesquelles il donne seul, du moins dans cette perspective
qui est celle de l'humanisme, du sens à nos vies.
La sagesse de l'amour
Je te propose de partir, pour la mieux cerner, d'une analyse
très simple de ce qui caractérise toute grande
oeuvre d'art.
Dans quelque domaine que ce soit, cette dernière
est toujours, au départ, caractérisée
par la particularité de son contexte culturel d'origine.
Elle est toujours marquée historiquement et géographiquement
par l'époque et l'« esprit du peuple»
dont elle est issue. C'est là, justement, son côté
«folklorique» - le mot folklore vient du mot
folk, qui veut dire «peuple» - sa dette
envers la logique de l'artisanat populaire, local, si tu
veux. On voit immédiatement, même sans être
un grand spécialiste, qu'une toile de Vermeer n'appartient
ni au monde asiatique, ni à l'univers arabo-musulman,
qu'elle n'est manifestement pas non plus localisable dans
l'espace de l'art contemporain, mais qu'elle a sûrement
plus à voir avec l'Europe du Nord du XVIIe siècle.
De même, à peine quelques mesures suffisent
parfois pour déterminer qu'une musique vient d'Orient
ou d'Occident, qu'elle est plus ou moins ancienne ou récente,
destinée à une cérémonie religieuse
ou plutôt dédiée à une danse,
etc. D'ailleurs, même les plus grandes oeuvres de
la musique classique empruntent aux chants et aux danses
populaires dont le caractère national n'est jamais
absent. Une polonaise de Chopin, une rapsodie hongroise
de Brahms, les danses populaires roumaines de Bartok le
disent explicitement. Mais, lors même que ce n'est
pas dit, le particulier d'origine laisse toujours des traces
et, si grande soit-elle, si universelle que soit sa portée,
la grande oeuvre n'a jamais tout à fait rompu les
liens avec son lieu et sa date de naissance.
Pourtant, c'est vrai, le propre de la grande oeuvre, à
la différence du folklore, c'est qu'elle n'est pas
rivée à un «peuple» particulier.
Elle s'élève à l'universel ou pour
mieux dire, si le mot fait peur, elle s'adresse potentiellement
à l'humanité tout entière. C'est ce
que Goethe appelait déjà, s'agissant des livres,
la «littérature mondiale» (Weltlitteratur).
L'idée de «mondialisation» n'était
nullement liée dans son esprit à celle d'uniformité
: l'accès de l'oeuvre au niveau mondial ne s'obtient
pas en bafouant les particularités d'origine, mais
en assumant le fait d'en partir et de s'en nourrir pour
les transfigurer toutefois dans l'espace de l'art. Pour
en faire quelque chose d'autre que du simple folklore.
Du coup, les particularités, au lieu d'être
sacralisées comme si elles n'étaient vouées
à ne trouver de sens que dans leur communauté
d'origine, sont intégrées dans une perspective
plus large, dans une expérience assez vaste pour
être potentiellement commune à l'humanité.
Et voilà pourquoi la grande oeuvre, à la différence
des autres, parle à tous les êtres humains,
quels que soient le lieu et le temps où ils vivent.
Maintenant, faisons un pas de plus.
Pour comprendre Naipaul, tu remarqueras que j'ai mobilisé
deux concepts, deux notions clefs : le particulier et l'universel.
Le particulier, c'est en l'occurrence, dans l'expérience
que décrit le grand écrivain, le point de
départ : la petite île, et même, plus
précisément, au sein de l'île, la communauté
indienne à laquelle appartient Naipaul. Et, en effet,
il s'agit bien d'une réalité particulière,
avec sa langue, ses traditions religieuses, sa cuisine,
ses rituels, etc. Et puis, à l'autre bout de la chaîne,
si l'on peut dire, il y a l'universel. Ce n'est pas seulement
le vaste monde, les autres, mais aussi la finalité
de l'itinéraire qu'entreprend Naipaul quand il s'attaque
aux «zones d'ombre », à ces éléments
d'altérité qu'il ne connaît ni ne comprend
à première vue.
Ce que je voudrais que tu comprennes, car c'est crucial
pour percevoir en quoi l'amour donne du sens, c'est qu'entre
ces deux réalités, le particulier et cet universel
qui se confond à la limite avec l'humanité
elle-même, il existe une place pour un moyen terme:
le singulier ou l'individuel. Or c'est ce dernier et lui
seul qui est, tout à la fois, l'objet de nos amours
et le porteur de sens.
Tâchons de voir cela d'un peu plus près afin
de rendre sensible cette idée qui est, tout simplement,
la poutre maîtresse de l'édifice philosophique
de l'humanisme sécularisé.
Pour nous aider à y voir plus clair, je partirai
d'une définition de la singularité, héritée
du romantisme allemand, dont tu vas pouvoir mesurer tout
l'intérêt pour notre propos.
Si, comme le veut depuis l'Antiquité grecque la logique
classique, on désigne sous le nom de «singularité»
ou d'«individualité» une particularité
qui n'en est pas restée au seul particulier mais
qui s'est fondue dans un horizon supérieur pour accéder
à plus d'universel, alors tu mesures en quoi la grande
oeuvre d'art nous en offre le modèle le plus parfait.
C'est parce qu'ils sont, en ce sens bien précis,
des auteurs d'oeuvres singulières, tout à
la fois enracinées dans leur culture d'origine et
dans leur époque, mais cependant capables de s'adresser
à tous les hommes de toutes les époques, que
nous lisons encore Platon ou Homère, Molière
ou Shakespeare, ou que nous écoutons encore Bach
ou Chopin.
Il en va ainsi de toutes les grandes oeuvres et même
de tous les grands monuments de l'histoire: on peut être
français, catholique, et cependant profondément
ébloui par le temple d'Angkor, par la mosquée
de Kairouan, par une toile de Vermeer ou une calligraphie
chinoise. Parce qu'ils se sont élevés jusqu'au
niveau suprême de la «singularité »,
parce qu'ils ont accepté de ne plus s'en tenir ni
au particulier qui formait, comme pour tout homme, la situation
initiale, ni à un universel abstrait, désincarné,
comme celui, par exemple, d'une formule chimique ou mathématique.
L'oeuvre d'art digne de ce nom n'est ni l'artisanat local,
ni non plus cet universel dénué de chair et
de saveur qu'incarne le résultat d'une recherche
scientifique pure. Et c'est cela, cette singularité,
cette individualité ni seulement particulière,
ni tout à fait universelle que nous aimons en elle.
Par où tu vois aussi par quel biais la notion de
singularité peut être rattachée directement
à l'idéal de la pensée élargie
: en m'arrachant à moi-même pour comprendre
autrui, en élargissant le champ de mes expériences,
je me singularise puisque je dépasse tout à
la fois le particulier de ma condition d'origine pour accéder,
sinon à l'universalité, du moins à
une prise en compte chaque fois plus large et plus riche
des possibilités qui sont celles de l'humanité
tout entière.
Pour reprendre un exemple simple: lorsque j'apprends une
langue étrangère, lorsque je m'installe pour
y parvenir dans un pays autre que le mien, je ne cesse,
que je le veuille ou non, d'élargir l'horizon. Non
seulement je me donne les moyens d'entrer en communication
avec plus d'êtres humains, mais toute une culture
s'attache à la langue que je découvre et,
ce faisant, je m'enrichis de manière irremplaçable
d'un apport extérieur à ma particularité
initiale.
En d'autres termes: la singularité n'est pas seulement
la caractéristique première de cette «
chose» extérieure à moi qu'est la grande
oeuvre d'art, mais c'est aussi une dimension subjective,
personnelle, de l'être humain comme tel. Et c'est
cette dimension, à l'exclusion des autres, qui est
le principal objet de nos amours. Nous n'aimons jamais
le particulier en tant que tel, jamais non plus l'universel
abstrait et vide. Qui tomberait d'ailleurs amoureux d'un
nourrisson ou d'une formule algébrique?
Si nous suivons encore le fil de la singularité,
auquel l'idéal de la pensée élargie
nous a conduits, il faut donc y ajouter la dimension de
l'amour : seul il donne sa valeur et son sens ultimes à
tout ce processus d'«élargissement» qui
peut et doit guider l'expérience humaine. Comme tel,
il est le point d'aboutissement d'une sotériologie
humaniste, la seule réponse plausible à la
question du sens de la vie - en quoi, une fois encore, l'humanisme
non métaphysique peut bien apparaître comme
une sécularisation du christianisme.
Un fragment, magnifique, des Pensées de
Pascal (323) t'aidera à mieux le comprendre. Il s'interroge,
en effet, sur la nature exacte des objets de nos affections
en même temps que sur l'identité du moi. Le
voici :
« Qu'est-ce que le moi?
« Un homme qui se met à la fenêtre pour
voir les passants; si je passe par là, puis-je dire
qu'il s'est mis là pour me voir? Non: car il ne pense
pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un
à cause de sa beauté l'aime-t-il? Non: car
la petite vérole, qui tuera la beauté sans
tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera plus.
« Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire,
m'aime-t-on moi? Non, car je puis perdre ces qualités
sans me perdre moi-même. Où donc est ce moi
s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme? Et comment
aimer le corps ou l'âme sinon pour ces qualités,
qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont
périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme
d'une personne abstraitement, et quelques qualités
qui y fussent? Cela ne se peut, et serait injuste. On n'aime
donc jamais personne, mais seulement des qualités.
«Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer
pour des charges et des offices, car on n'aime personne
que pour des qualités empruntées.»
La conclusion que l'on tire généralement de
ce texte est la suivante: le moi, dont Pascal ne cesse par
ailleurs de dire qu'il est «haïssable »,
parce que toujours plus ou moins voué à l'égoïsme,
n'est pas un objet d'amour défendable. Pourquoi?
Tout simplement parce que nous tendons tous à nous
attacher aux particularités, aux qualités
«extérieures» des êtres que nous
prétendons aimer: beauté, force, humour, intelligence,
etc., voilà ce qui, d'abord, nous séduit.
Mais comme de tels attributs sont éminemment périssables,
l'amour finit un jour ou l'autre par céder la place
à la lassitude et à l'ennui. C'est même
là, selon Pascal, l'expérience la plus commune
:
«Il n'aime plus cette personne qu'il aimait il y a
dix ans. Je crois bien! Elle n'est plus la même, ni
lui non plus. Il était jeune et elle aussi; elle
est tout autre. Il l'aimerait peut-être encore, telle
qu'elle était alors» (Pensées,
123).
Eh oui : loin d'avoir aimé en l'autre ce qu'on prenait
pour son essence la plus intime, ce que nous avons nommé
ici sa singularité, on ne s'est attaché qu'à
des qualités particulières et par conséquent
tout à fait abstraites en ce sens qu'on pourrait
tout aussi bien les retrouver chez n'importe qui d'autre.
La beauté, la force, l'intelligence, etc., ne sont
pas propres à tel ou tel, elles ne sont nullement
liées de manière intime et essentielle à
la «substance» d'une personne à nulle
autre pareille, mais elles sont, pour ainsi dire, interchangeables.
S'il persiste dans la logique qui fut la sienne au départ,
il est probable que notre ancien amant du fragment 123 va
divorcer pour chercher une femme plus jeune et plus belle,
et en cela très semblable à celle qu'il avait
épousée dix ans plus tôt…
Bien avant les philosophes allemands du XIXe siècle,
Pascal découvre que le particulier brut et l'universel
abstrait, loin de s'opposer, «passent l'un dans l'autre»
et ne sont que les deux faces d'une même réalité.
Pour dire les choses plus simplement, réfléchis
à cette expérience toute bête: quand
tu téléphones à quelqu'un, si tu lui
dis seulement, «Allô! C'est moi», voire
«C'est moi-même», cela ne lui indiquera
rien. Ce « moi» abstrait n'a rien d'une singularité
car tout le monde peut dire «c'est moi»
au même titre que toi! Seule la prise en compte
d'autres éléments permettra peut-être
à ton correspondant de t'identifier. Par exemple
ta voix, mais sûrement pas, en tout cas, la simple
référence au moi qui reste paradoxalement
de l'ordre du général, de l'abstrait, de ce
qu'il y a de moins aimable.
De la même façon, je crois saisir le coeur
d'un être, ce qu'il a de plus essentiel, d'absolument
irremplaçable en l'aimant pour ses qualités
abstraites, mais la réalité est tout autre:
je n'ai saisi de lui que des attributs aussi anonymes qu'une
charge ou une distinction honorifiques, et rien de plus.
En d'autres termes: le particulier n'était pas
le singulier.
Or il faut que tu comprennes bien que seule la singularité,
qui dépasse à la fois le particulier et l'universel,
peut être objet d'amour.
Si l'on s'en tient aux seules qualités particulières/générales,
on n'aime jamais vraiment personne et, dans cette optique,
Pascal a raison, il faut cesser de moquer les vaniteux qui
prisent les honneurs. Après tout, que l'on mette
en avant sa beauté ou ses médailles revient
à peu près au même : la première
est (presque) aussi extérieure à la personne
que les secondes. Ce qui fait qu'un être est aimable,
ce qui donne le sentiment qu'on pourrait continuer à
l'aimer quand bien même la maladie l'aurait défiguré,
n'est pas réductible à une qualité,
si importante soit-elle. Ce que l'on aime en lui (et qu'il
aime en nous, le cas échéant) et que par conséquent
nous devons développer pour autrui comme en soi,
ce n'est ni la particularité pure, ni les qualités
abstraites (l'universel), mais la singularité qui
le distingue et le rend à nul autre pareil. À
celui ou celle qu'on aime, on peut dire affectueusement,
comme Montaigne, «parce que c'était lui, parce
que c'était moi», mais pas: «parce qu'il
était beau, fort, intelligent»...
Et cette singularité, tu t'en doutes, n'est pas donnée
à la naissance. Elle se fabrique de mille manières;
sans d'ailleurs que nous en soyons toujours conscients,
loin de là. Elle se forge au fil de l'existence,
de l'expérience, et c'est pourquoi, justement, elle
est, au sens propre, irremplaçable. Les nourrissons
se ressemblent tous. Comme les petits chats. Ils sont adorables,
bien sûr, mais c'est vers l'âge d'un mois, avec
l'apparition de son premier sourire, que le petit d'homme
commence à devenir humainement aimable.
Car c'est à ce moment qu'il entre dans une histoire
proprement humaine, celle du rapport à autrui.
En quoi l'on peut aussi, toujours en suivant le fil rouge
de la pensée élargie et de la singularité
ainsi entendue, réinvestir l'idéal grec de
cet «instant éternel», ce présent
qui, par sa singularité, justement, parce qu'on le
tient pour irremplaçable et qu'on en mesure l'épaisseur
au lieu de l'annuler au nom de la nostalgie de ce qui le
précède ou l'espoir de ce qui pourrait le
suivre, se libère des angoisses de mort liées
à la finitude et au temps.
C'est en ce point, à nouveau, que la question du
sens rejoint celle du salut. Si l'arrachement au particulier
et l'ouverture à l'universel forment une expérience
singulière si ce double processus tout à la
fois singularise nos propres vies et nous donne accès
à la singularité des autres, il nous offre
en même temps que le moyen d'élargir la pensée
celui de la mettre en contact avec des moments uniques,
des moments de grâce d'où la crainte de la
mort, toujours liée aux dimensions du temps extérieures
au présent, est absente.
Tu m'objecteras peut-être que, par rapport à
la doctrine chrétienne, par rapport notamment à
la promesse qu'elle nous fait, avec la résurrection
des corps, de retrouver après la mort ceux que nous
aimons, l'humanisme non métaphysique ne pèse
pas lourd. Je te l'accorde volontiers : au banc d'essai
des doctrines du salut, rien ne peut concurrencer le christianisme...
pourvu, cependant, que l'on soit croyant.
Si on ne l'est pas - et on ne peut tout de même pas
se forcer à l'être ni faire semblant - alors
il faut apprendre à considérer autrement la
question ultime de toutes les doctrines du salut, à
savoir celle du deuil de l'être aimé.
Voici, à mon sens, comment.
Le deuil d'un être aimé
II y a, à mes yeux, trois façons de penser
au deuil d'une personne que l'on aime, trois façons,
si tu veux, de t'y préparer.
On peut être tenté par les recommandations
du bouddhisme - qui rejoignent d'ailleurs, presque mot pour
mot, celles des stoïciens. Elles se résument
au fond à un précepte premier: ne pas s'attacher.
Non pas par indifférence - une fois encore, le bouddhisme,
comme le stoïcisme, plaide pour la compassion, et même
pour les devoirs de l'amitié. Mais par précaution:
si nous nous laissons peu à peu piéger par
les attachements que l'amour installe toujours en nous,
nous nous préparons inévitablement les pires
souffrances qui soient puisque la vie est changement, impermanence,
et que les êtres sont tous périssables. Bien
plus, ce n'est pas seulement du bonheur, de la sérénité
que nous nous privons par avance, mais de la liberté.
Les mots sont d'ailleurs parlants : être attaché,
c'est être lié, non libre et si l'on
veut s'affranchir de ces liens que tisse l'amour, il faut
s'exercer le plus tôt possible à cette forme
de sagesse qu'est le non-attachement.
Une autre réponse, rigoureusement inverse, est celle
des grandes religions, surtout du christianisme puisque
seul il professe la résurrection des corps et non
seulement des âmes. Elle consiste, tu t'en souviens,
à promettre que si nous pratiquons, avec les êtres
chers, l'amour en Dieu, l'amour qui porte en eux sur ce
qu'ils ont d'éternel plutôt que de mortel,
nous aurons le bonheur de les retrouver - de sorte que l'attachement
n'est pas prohibé pourvu qu'il soit convenablement
situé. Cette promesse est symbolisée dans
l'Evangile par l'épisode relatant la mort de Lazare,
un ami du Christ. Comme le premier être humain venu,
le Christ pleure lorsqu'il apprend que son ami est mort
- ce que Bouddha ne se serait jamais permis de faire. Il
pleure parce que ayant pris forme humaine, il éprouve
en lui la séparation comme un deuil, une souffrance.
Mais, bien entendu, il sait qu'il va bientôt retrouver
Lazare, parce que l'amour est plus fort que la mort.
Voilà donc deux sagesses, deux doctrines du salut,
qui pour être en tout point, ou presque, opposées,
n'en traitent pas moins, comme tu vois, le même problème:
celui de la mort des êtres chers.
Pour te dire très simplement ce que j'en pense, aucune
de ces deux attitudes, si profondes puissent-elles paraître
à certains, ne me convient. Non seulement je ne puis
m'empêcher de m'attacher, mais je n'ai pas même
envie d'y renoncer. Je n'ignore à peu près
rien des souffrances à venir - j'en connais même
déjà l'amertume. Mais, comme l'avoue d'ailleurs
le dalaï-lama, le seul véritable moyen de vivre
le non-attachement est la vie monastique, au sens étymologique
du terme: il faut vivre seul pour être libre, pour
éviter les liens et pour tout te dire, je crois qu'il
a raison. Il me faut donc renoncer à la sagesse des
bouddhistes comme j'ai renoncé à celle des
stoïciens. Avec respect, estime et considération,
mais cependant une irrémédiable distance.
Je trouve le dispositif chrétien infiniment plus
tentant... à ce détail près que je
n'y crois pas. Mais si c'était vrai, comme dit l'autre,
je serais volontiers preneur. Je me souviens de mon ami
François Furet, l'un des plus grands historiens français
pour lequel j'avais une très grande affection. Un
jour, il fut invité à la télévision,
chez Bernard Pivot, qui terminait toujours son émission
par le fameux questionnaire de Proust. Une dizaine de questions,
donc, auxquelles on doit répondre brièvement.
La dernière demande ce que nous aimerions que Dieu
nous dise si nous le rencontrions. François, qui
était on ne peut plus athée, avait répondu
sans hésiter, comme le premier chrétien venu:
«Entre vite, tes proches t'attendent!»
J'aurais dit comme lui, et comme lui, je n'y crois pas non
plus.
Alors que faire, à part attendre la catastrophe en
y pensant le moins possible?
Peut-être rien, en effet, mais peut-être aussi,
malgré tout, développer sans illusion, en
silence, juste pour soi quelque chose comme une «sagesse
de l'amour». Chacun sait bien, par exemple, qu'il
faut se réconcilier avec ses parents - presque inévitablement,
la vie a créé des tensions - avant qu'ils
ne disparaissent. Car après, quoi qu'en dise le christianisme,
c'est trop tard. Si l'on pense que le dialogue avec les
êtres chers n'est pas infini, il faut en tirer les
conséquences.
Je t'en indique une, au passage, pour te donner juste une
idée de ce que j'entends ici par sagesse de l'amour.
Je pense que les parents ne doivent jamais mentir sur des
choses importantes à leurs enfants. Je connais, par
exemple, plusieurs personnes qui ont découvert, après
la mort de leur père, qu'il n'était pas leur
père biologique - soit que leur mère ait eu
un amant, soit qu'une adoption ait été cachée.
Dans tous les cas de figure, ce genre de mensonge fait des
dégâts considérables. Pas simplement,
loin de là, parce que la découverte, un jour
ou l'autre, de la vérité tourne invariablement
au désastre. Mais surtout parce que, après
la mort du père qui ne l'était pas au sens
ordinaire, il est impossible à l'enfant devenu adulte
de s'expliquer avec lui, de comprendre un silence, une remarque,
une attitude qui l'ont marqué et sur lesquels il
aimerait pouvoir mettre un sens - ce qui lui est désormais
interdit à jamais.
Je n'insiste pas davantage - je t'ai dit que cette sagesse
de l'amour me semblait devoir être élaborée
par chacun d'entre nous et, surtout, en silence. Mais il
me semble que nous devrions, à l'écart du
bouddhisme et du christianisme, apprendre enfin à
vivre et à aimer en adultes, en pensant, s'il le
faut, chaque jour à la mort. Point par fascination
du morbide. Tout au contraire, pour chercher ce qu'il convient
de faire ici et maintenant, dans la joie, avec ceux que
nous aimons et que nous allons perdre à moins qu'ils
ne nous perdent avant. Et je suis sûr, même
si je suis encore infiniment loin de la posséder,
que cette sagesse-là existe et qu'elle constitue
le couronnement d'un humanisme enfin débarrassé
des illusions de la métaphysique et de la religion.
Luc Ferry,
Apprendre à vivre, Traité de philosophie
destiné aux jeunes générations,
Éditions Plon,
2006, pp. 276-292