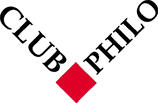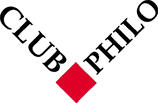La perte de mémoire est sans doute une des situations
psycho-physiologiques qui, dans notre imaginaire, est source
intarissable de phantasmes anxiogènes. Nombre de films
de série B du cinéma fantastique d’après-guerre,
de comics, se sont emparés de ce thème. L’absence
de mémoire est en effet associée à une
désorientation globale et critique de l’individu
; la désintégration du passé est pensée
comme désintégration de l’identité
psychique du sujet amnésique ; celui qui oublie serait
dès lors hanté par son passé, souffrant
à la manière de cet amputé qui n’a
de cesse de se plaindre de douleurs du membre désormais
fantôme. L’absence même de passé
serait donc habitée par sa présence paradoxale.
Nous imaginons ainsi l’amnésique plongé
dans une recherche épuisante, désespérante
de traces mnésiques, de vestiges mémoriels ;
chaque instant de son présent serait un moment de recherche
du passé ; son présent serait condamné
à être rétroprojectif, lancé vers
le passé, comme une voix qui attendrait derrière
elle,fébrilement, son écho.
Cet état de souffrance, d’exaspération
devant le vide, le néant de la mémoire, serait
tel que c’est l’intégrité psychique
de l’amnésique qui en serait altérée
; pathologie physiologique aux conséquences psychiatriques
: on imagine alors que la folie n’est pas loin de l’amnésie.
On imagine enfin l’amnésie comme expérience
de la mort, comme menant à la mort.
« On imagine » mais avons-nous la possibilité
de nous mettre à la place de l’amnésique
? Cette expérience imaginée, imaginaire, est-elle
possiblement adéquate à l’expérience
vécue de celui qui a perdu son passé ? Ne sommes-nous
pas dans la même impasse que lorsque nous nous imaginons
aveugles pour mieux comprendre la supposée angoisse
de l’aveugle et que nous oublions que celui-ci ne vit
pas son aveuglement comme un manque mais comme une donnée
contingente ? Nous ne pouvons ainsi imaginer ce qu’un
amnésique vit parce que nous sommes immergés
dans une représentation du temps toute entière
fondée sur la mémoire et dont nous ne pouvons
nous affranchir au moment même où nous essayons
de nous représenter dans cet état d’amnésie.
La catharsis trouve ici sa limite phénoménologique.
Il semble que Kaurismaki ait pris en charge cette impossibilité
en refusant toute psychologisation, en adoptant une focalisation
externe sur son personnage ; à moins que ce refus soit
le signe d’une compréhension opposée à
celle que l’on vient de présenter : si il n’y
a pas de psychologisation, c’est qu’il n’y
a pas ici d’intériorité à décrire
; cet amnésique, du fait même de son absence
de passé, ne peut se replier sur lui-même, sur
ses souvenirs, ses regrets, ses remords ; il est tout entier
livré à l’extériorité du
monde. On note ainsi une opposition entre l’univers
nocturne, urbain, clos des premiers moments où le personnage
est encore homme de mémoire et les plans lumineux,
naturels, du ciel, de la mer, qui lui offrent une ouverture
quasi cosmique. Il est alors, pour reprendre l’expression
de Sartre, « comme un grand vent » ; il est désormais
projeté dans un présent qui ne se nourrit plus
du passé mais qui est tendu vers l’avenir. Comme
le pense Nietzsche, l’oubli a ici sa positivité
en tant qu’il abolit toute détermination par
le passé et qu’il autorise toutes les aventures.
C’est au moment où des bribes du passé
apparaissent que l’avenir du héros s’assombrit…
Kaurismaki ne nous montre pas seulement un homme qui a perdu
la mémoire ; un détail a ici une importance
capitale : avant d’être roué de coups et
sombrer dans l’amnésie, il s’aperçoit
que sa montre est cassée. A son réveil, il est
livré à la fois à un présent sans
passé et à un écoulement du temps qui
a changé de nature ; il n’est plus soumis à
la mécanique des aiguilles qui déterminent le
temps objectif ; il est maintenant livré à un
temps subjectif, au temps de ses sensations, de ses désirs,
de ses affects. C’est là qu’il renoue avec
sa subjectivité alors qu’auparavant il était
ce soudeur qui vivait le temps comme l’espace contraignant
de ses obligations sociales (auquel il essayait d’échapper,
on l’apprendra plus tard, en jouant). C’est là
qu’il retrouve un temps réconcilié avec
la nature. L’attention qu’il porte à son
modeste jardin, le souci qu’il a des saisons, en témoignent.
Réconciliation paradoxale avec le temps, avec la durée
(ref. Bergson). Réconciliation aussi avec la Nature
autant qu’avec sa nature.
Réconciliation qui trouve néanmoins ses limites.
Ce personnage est ancré dans une réalité
sociale qui fait obstacle à cette réalisation
de soi. Tout d’abord, souvenons-nous que le personnage
est déclaré mort suite à son agression
; c’est dire comme l’amnésie est synonyme
de mort sociale. Sans référence possible au
passé, pas d’identification possible, pas de
repérage possible de l’individu…la mémoire
individuelle a donc une fonction de contrôle socio-politique
: être en mesure de se référencer à
son passé, de s’inscrire dans une généalogie,
c’est présenter ses coordonnées dans le
plan social, c’est pouvoir être repérable,
contrôlable. L’homme sans mémoire représente
ainsi un véritable danger pour la société
en tant que son errance est l’indice de sa liberté,
de son affranchissement aux normes temporelles, sociales,
politiques, administratives.
Cette identification des individus exigée par les différentes
institutions s’attache à des éléments
objectifs (le nom, l’âge,etc.) assez sommaires
pour supporter une amnésie partielle, voire une amnésie
totale pourvu que l’amnésique soit capable de
s’inventer une nouvelle identité, un nouveau
nom qui sera son nouvel identifiant, sa signature symbolique
dans l’espace social ; les institutions supportent donc
la fiction identitaire…peu importe la vérité
de l’individu pourvu qu’il ait sa « marque
». Or le personnage central du film refuse ce marché
de dupes où l’on donne son nom pour être
admis dans la communauté.
Il y a pourtant un attachement plus profond, plus affectif
au nom : c’est cet attachement qui est signifié
par la résistance d’Irma à donner son
nom, puis du personnage à donner le nom de sa fiancée.
A côté du langage fonctionnel, il y a le langage
des cœurs ; à côté de la corruption,
il y a la pureté de sentiments qui appartiennent à
ceux qui sont en marge et qui n’ont pas oublié
les vertus de générosité, de pitié,…on
est ici dans une perspective toute rousseauiste dans une Finlande
qui souffre des symptômes de la modernité. La
perte de mémoire permet au héros de retrouver
les lignes d’une nature humaine originelle, vertueuse,
pas encore corrompue.
Il y a donc une fonctionnalité de la mémoire,
ou tout au moins des références des individus.
Fonction sociale, politique mais aussi d’ordre économique.
On a vu que la vérité était une valeur
oubliée de la société ; la valeur est
ici monétaire. Si l’on s’invente un nom,
c’est pour vivre, gagner sa vie ; si l’on donne
son nom, c’est pour ouvrir un compte bancaire…le
film se présente ainsi comme une critique des rouages
économiques et financiers d’une société
qui ne trouve de sens qu’à travers la marchandisation
des échanges - entraînant leur déshumanisation.
Comme le dit le vigile corrompu, il représente l’Etat…peu
importe la notion de bien ou de mal ; les notions de péché,
de culpabilité sont abolis pour laisser place à
celle de profit.
Ce film a-t-il dès lors une vision idéologique
? La notion « idéologique » est bien plutôt
mise à mal ; souvenons-nous du prétexte qu’avance
le héros pour émanciper un tant soit peu le
groupe musical de l’Armée du Salut ; il évoque
« l’idéologie » sans que jamais celle-ci
soit définie, comme si elle n’était qu’une
valeur en creux, une valeur vide. Si l’on peut lire
ce film comme une critique marxienne, il n’appelle pas
à la révolution marxiste…Le cynisme, le
pessimisme viscéral de Kaurismaki, balaye l’idéologie.
Comment alors comprendre la morale de cette fable ? Car en
effet, il y a ici une fable qui attend sa morale. Fable de
cette femme qui rêve au prince charmant, telle une petite
fille aux allumettes dans sa chambre ; fable de cet homme
qui l’emmène avec lui, bravant le passé,
le présent et l’avenir ; fable de ce vigile qui
se réconcilie avec l’humain ; fable de cette
musique qui adoucit les mœurs et ouvre à «
l’idéologie ». Pourtant si il n’y
a pas d’arrière-plan idéologique, de transcendance
possible, comment alors comprendre le monde de Kaurismaki
? Que désigne-t-il ? De quoi est-il la métaphore,
l’allégorie ?
Reste le réel. Un réel derrière lequel
il n’y a rien à lire car il est la seule réalité,
la seule vérité. Kaurismaki est un peintre réaliste
qui nous montre les objets du monde dans leur pureté,
dans leur absence d’ambivalence, de métaphorisation.
Le réel est dépouillé de tout symbolisme
; il est « idiot » au sens étymologique
(ref Traité de l’idiotie, Clément Rosset).
Souvenons-nous de la scène où le personnage
et son ami SDF sont dans un café ; le second lui désigne
des objets qu’il doit nommer ; ces mots n’ont
aucune fonction métaphorique : ils disent le réel.
Reste alors le burlesque, l’humour qui traversent le
film…c’est sans doute là le mode de libération
du réel le plus adéquat. C’est à
travers le rire qu’un espoir peut filer.
Christophe Auriault
|