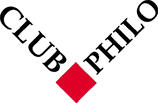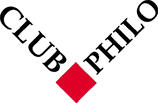|

Galerie de portraits
ll Dictionnaire du Club
Frédéric
Laupies : Éducation et liberté |
| |
 |
Aristote,
Métaphysique A, 2, 982 b 10, trad. J.
Tricot, Vrin.
C'est, en effet, l'étonnement qui poussa, comme
aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations
philosophiques. Au début, leur étonnement
porta sur les difficultés qui se présentaient
les premières à l'esprit ; puis, s'avançant
ainsi peu à peu, ils étendirent leur exploration
à des problèmes plus importants, tels que
les phénomènes de la Lune, ceux du Soleil
et des Étoiles, enfin la genèse de l'Univers.
Or apercevoir une difficulté et s'étonner,
c'est reconnaître sa propre ignorance (c'est pourquoi
même l'amour des mythes est, en quelque manière
amour de la Sagesse, car le mythe est un assemblage de
merveilleux). Ainsi donc, si ce fut bien pour échapper
à l'ignorance que les premiers philosophes se livrèrent
à la philosophie, c'est qu'évidemment ils
poursuivaient le savoir en vue de la seule connaissance
et non pour une fin utilitaire. Et ce qui s'est passé
en réalité en fournit la preuve : presque
toutes les nécessités de la vie, et les
choses qui intéressent son bien-être et son
agrément avaient reçu satisfaction, quand
on commença à rechercher une discipline
de ce genre. Je conclus que, manifestement, nous n'avons
en vue, dans notre recherche, aucun intérêt
étranger. Mais, de même que nous appelons
libre celui qui est à lui-même sa fin et
n'existe pas pour un autre, ainsi cette science est aussi
la seule de toutes les sciences qui soit une discipline
libérale, puisque seule elle est à elle-même
sa propre fin. |
Descartes,
Traité des passions de l’âme
Art.152, Pour quelle cause on peut s’estimer
Et parce que l’une des principales parties de la
sagesse est de savoir en quelle façon et pour quelle
cause chacun se doit estimer ou mépriser, je tacherai
ici de dire mon opinion. Je ne remarque en nous qu’une
seule chose qui nous puisse donner juste raison de nous
estimer, à savoir l’usage de notre libre
arbitre, et l’empire que nous avons sur nos volontés
; car il n’y a que les seules actions qui dépendent
de ce libre arbitre pour lesquelles nous puissions avec
raison être loués ou blâmés
; et il nous rend en quelque façon semblable à
Dieu en nous faisant maître de nous-mêmes,
pourvu que nous ne perdions point par lâcheté
les droits qu’il nous donne.
Art. 153, En quoi consiste la générosité
Ainsi je crois que la vraie générosité,
qui fait qu’un homme s’estime au plus haut
point qu’il se peut légitimement estimer
consiste seulement partie en ce qu’il connaît
qu’il n’y a rien qui véritablement
lui appartienne que cette libre disposition de ses volontés,
ni pourquoi il doive être loué ou blâmé
sinon pour ce qu’il en use bien ou mal, et partie
en ce qu’il sent en soi-même une ferme et
constante résolution d’en bien user, c’est-à-dire
de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre
et exécuter toutes les choses qu’il jugera
être les meilleures ; ce qui est suivre parfaitement
la raison.
Art. 154, Qu’elle empêche qu’on
ne méprise les autres.
Ceux qui ont cette connaissance et ce sentiment d’eux-
mêmes se persuadent facilement que chacun des autres
hommes les peut aussi avoir de soi, parce qu’il
n’y a rien en cela qui dépende d’autrui.
C’est pourquoi ils ne méprisent jamais personne;
et, bien qu’ils voient souvent que les autres commettent
des fautes qui font paraître leur faiblesse, ils
sont toutefois plus enclins à les excuser qu’à
les blâmer, et à croire que c’est plutôt
par manque de connaissance que par manque de bonne volonté
qu’ils les commettent; et, comme ils ne pensent
point être de beaucoup inférieurs à
ceux qui ont plus de bien ou d’honneurs, ou même
qui ont plus d’esprit, plus de savoir, plus de beauté,
ou généralement qui les surpassent en quelques
autres perfection aussi ne s’estiment-ils point
beaucoup au-dessus de ceux qu’ils sur passent à
cause que toutes ces choses leur semblent être fort
peu considérables, à comparaison de la bonne
volonté, pour laquelle seule ils s’estiment,
et laquelle ils supposent aussi être ou du moins
pouvoir être en chacun des autres hommes. |
Hegel,
Principes de la philosophie du droit, Introduction,
§5
Sans doute l’aspect de la volonté défini
ici – cette possibilité absolue de m’abstraire
de toute détermination où je me trouve ou
bien où je suis placé, cette fuite devant
tout contenu comme devant toute restriction – est-ce
à quoi la volonté se détermine. C’est
ce que la représentation pose pour soi comme liberté
et ce n’est ainsi que la liberté négative
ou liberté de l’entendement.
C’est la liberté du vide. Elle peut se manifester
sous une figure réelle et devenir une passion.
Alors si elle reste simplement théorique, c’est
le fanatisme religieux de la pure contemplation indoue
; si elle se tourne vers l’action, c’est en
politique comme en religion, le fanatisme de la destruction
de tout ordre social existant et l’excommunication
de tout individu suspect de vouloir un ordre et l’anéantissement
de toute organisation voulant se faire jour. Ce n’est
qu’en détruisant que cette volonté
négative a le sentiment de son existence. Elle
pense qu’elle veut un état positif, par exemple,
l’état de l’égalité universelle
ou de la vie religieuse universelle, mais en fait elle
n’en veut pas la réalité positive,
car celle-ci introduit aussitôt un ordre quelconque,
une détermination singulière aussi bien
des institutions que des individus, alors que c’est
en niant cette spécification et cette détermination
objective, que précisément la liberté
négative devient consciente de soi. Ainsi ce qu’elle
croit vouloir peut n’être pour soi qu’une
représentation abstraite et sa réalisation
n’être qu’une furie de destruction.
|
Maine
de Biran, Influence de l’habitude
sur la faculté de penser
Nous ne pouvons guère plus cesser de percevoir
quelque chose qui nous résiste, que cesser de sentir
notre propre existence. L'impression d'effort est la première
et la plus profonde de toutes nos habitudes ; elle subsiste
pendant que les autres modifications passent et se succèdent
; elle coïncide donc avec toutes, et leur fournit
une base où elles s'attachent, se fixent.
Mais l'effort suppose deux termes, ou plutôt un
sujet et un terme essentiellement relatifs l'un à
l'autre ; c'est bien toujours le sujet qui est modifié,
mais, s'il ne faisait que sentir, il demeurerait identifié
avec sa modification, et s'ignorerait lui-même ;
il ne peut se connaître sans se circonscrire, sans
se comparer à son terme ; c'est dans ce dernier
qu'il se perçoit, qu'il se mire en quelque sorte,
c'est donc là qu'il rapportera également
tout ce qu'il distingue et compare.
Tel est le fondement de ce rapport d'inhérence
de nos modifications plus ou moins affectives (pourvu
qu'elles n'occupent pas toute la faculté de sentir)
aux parties du corps qui en sont le siège et surtout
des impressions indifférentes et distinctes au
soutien extérieur et résistant sur lequel
elles se cumulent : jugement premier et devenu si profondément
habituel, qu'il ne fallait rien moins que toute la puissance
de la réflexion pour s'en étonner et en
interroger les causes ! ...
Nos modifications associées par simultanéité
à la résistance, et transportées
hors de nous, sont déjà loin, sans doute,
de leur caractère simple et individuel ; comme
sensations pures, elles seraient en quelque sorte isolées
ou sans lien commun qui les unit ; comme qualités
de l'objet, elles se groupent, se pressent autour de lui,
y adhèrent avec force, et se combinent en une seule
perception, représentée au dehors par l'unité
résistante, de même qu'une série d'unités
simples se trouve réunie et fixée par un
signe unique ; et en effet, le signe naturel remplit le
même office pour les sens et l'imagination, que
le symbole artificiel pour la mémoire (comme nous
le verrons ailleurs).Pour que la sensation se transforme
en perception, il faut un premier avertissement transmis
directement au centre cérébral et une réaction
de ce centre pour mouvoir ou tendre l'organe, ce qui suppose
que ce dernier est doué d'une certaine mobilité,
que les nerfs par lesquels il sent et se meut en même
temps, prennent immédiatement leur origine dans
le cerveau et y aboutissent d'une certaine manière,
peut-être dans un tel état de division, sans
être trop pressés ou confondus dans leur
cylindre, etc.
Dans ces deux actes simultanés ou rapidement successifs
du même centre pour sentir et mouvoir, l'individu
prend connaissance de lui-même comme moteur et sentant,
comme agent et patient. Si l'action sensitive était
seule, le moi serait absolument simple, il n'y aurait
point de personnalité. Au contraire dans le mouvement
même, il y a double impression, celle qui provient
de l'action du centre sur l'organe mobile, à laquelle
correspond ce que nous appelons volonté, et celle
qui résulte de la réaction de l'organe sur
le centre, que nous avons nommée effort. Si les
phénomènes du mouvement et du sentiment
dépendaient de quelque fluide, on pourrait supposer
avec vraisemblance qu'au moment du passage du fluide des
nerfs dans les muscles, et de la contraction de ces derniers,
il se fait un changement, soit dans la combinaison chimique
du fluide, soit dans sa direction et sa vitesse. Ce changement
donne à l'individu la conscience d'effort, il connaît
par là quelque chose qui résiste. |
Alain, Les
idées et les ages
Je crois voir un animal qui fuit ; tout me prouve que
j’ai mal vu ; mais enfin je n’arrive pas toujours
à retrouver l’apparence trompeuse, soit une
feuille morte roulée par le vent, qui me fasse
dire : « C’est cela même que j’ai
vu, et qui n’est qu’une feuille morte roulée
par le vent. » Toutefois le plus souvent je retrouve
l’apparence, et c’est cela même qui
est percevoir. La nuit, et ne dormant pas, j’entends
ce pas de loup, si redouté des enfants. Quelqu’un
marche ; il n’y a point de doute. Toutefois je doute,
j’enquête ; je retrouve un léger battement
de porte fermée, par la pres¬sion de l’air
qui agit comme sur l’anche, mais plus lentement.
Je reviens à mon premier poste, et cette fois,
je retrouve mon rêve, mais je l’explique.
Je crois voir une biche en arrêt ; je m’approche
; ce n’est qu’une souche d’arbre, où
deux feuilles font des oreilles pendantes. Je me recule
de nouveau ; de nouveau je crois voir la biche, mais en
même temps, je vois ce que c’est que je croyais
voir, et que c’est une souche d’arbre. En
même temps je connais l’apparence, et l’objet
dans l’apparence. À un degré de réflexion
de plus, qui ne manque guère en l’homme percevant,
et qui fait la joie et la lumière de ce monde,
je m’explique l’illusion même par la
disposition des objets ; ainsi je ris à ma jeunesse,
je la retrouve et je la sauve. « Autrefois ou tout
à l’heure je voyais ceci ou cela ; et maintenant
je vois encore la même chose et c’est toujours
la même chose ; je me trompais et ne me trompais
point. » Apprendre se trouve ici, ou bien ne se
trouve jamais. Apprendre c’est sauver l’erreur,
bien apprendre, c’est la sauver toute. Le vrai astronome
se plaît à voir tourner les étoiles,
et n’essaie plus de ne point les voir tournant.
Il ne sacrifie rien de l’apparence, et retrouve
tout le rêve chaldéen. Ce mouvement de surmonter
en conservant est dans la moindre de nos perceptions,
et c’est ce qui la fait perception. Je sais que
je vois un cube, mais en même temps je sais que
ce que je vois n’a point six faces ni vingt-quatre
angles droits ; en même temps je sais pourquoi.
Tout cela ensemble, c’est voir un cube.
|
Henri Bergson,
Les deux sources de la morale et de la religion
On ne se lasse pas de répéter que l'homme
est bien peu de chose sur la terre, et la terre dans l'univers.
Pourtant, même par son corps, l'homme est loin de
n'occuper que la place minime qu'on lui octroie d'ordinaire,
et dont se contentait Pascal lui-même quand il réduisait
le « roseau pensant » à n'être,
matériellement, qu'un roseau. Car si notre corps
est la matière à laquelle notre conscience
s'applique, il est coextensif à notre conscience,
il comprend tout ce que nous percevons, il va jusqu'aux
étoiles. Mais ce corps immense change à
tout instant, et parfois radicalement, pour le plus léger
déplacement d'une partie de lui-même qui
en occupe le centre et qui tient dans un espace minime.
Ce corps intérieur et central, relativement invariable,
est toujours présent. Il n'est pas seulement présent,
il est agissant : c'est par lui, et par lui seulement,
que nous pouvons mouvoir d'autres parties du grand corps.
Et comme l'action est ce qui compte, comme il est entendu
que nous sommes là où nous agissons, on
a coutume d'enfermer la conscience dans le corps minime,
de négliger le corps immense. On y paraît
d'ailleurs autorisé par la science, la¬quelle
tient la perception extérieure pour un épiphénomène
des processus intra-cérébraux qui y correspondent
: tout ce qui est perçu du plus grand corps ne
serait donc qu'un fantôme projeté au dehors
par le plus petit. Nous avons démasqué l'illusion
que cette métaphysique renferme. Si la surface
de notre très petit corps organisé (organisé
précisément en vue de l'action immédiate)
est le lieu de nos mouvements actuels, notre très
grand corps inorganique est le lieu de nos actions éventuelles
et théoriquement possibles : les centres perceptifs
du cerveau étant les éclaireurs et les préparateurs
de ces actions éventuelles et en dessinant intérieurement
le plan, tout se passe comme si nos perceptions extérieures
étaient construites par notre cerveau et projetées
par lui dans l'espace. Mais la vérité est
tout autre, et nous sommes réellement, quoique
par des parties de nous-mêmes qui varient sans cesse
et où ne siègent que des actions virtuelles,
dans tout ce que nous percevons. Prenons les choses de
ce biais, et nous ne dirons même plus de notre corps
qu'il soit perdu dans l'immensité de l'univers. |
Paul Valéry,
Eupalinos
Ce corps est un instrument admirable, dont je m’assure
que les vivants, qui l’ont tous à leur service,
n’usent pas dans sa plénitude. Ils n’en
tirent que du plaisir, de la douleur, des actes indispensables,
comme de vivre. Tantôt ils se confondent avec lui
; tantôt ils oublient quelque temps son existence
; et tantôt brutes, tantôt purs esprits, ils
ignorent quelles liaisons universelles ils contiennent,
et de quelle substance prodigieuse ils sont faits. Par
elle cependant, ils participent de ce qu’ils voient
et de ce qu’ils touchent : ils sont pierres, ils
sont arbres ; ils échangent des contacts et des
souffles avec la matière qui les englobe. Ils touchent,
ils sont touchés, ils pèsent et soulèvent
des poids ; ils se meuvent et transportent leurs vertus
et leurs vices ; et quand ils tombent dans la rêverie,
ou dans le sommeil indéfini, ils reproduisent la
nature des eaux, ils se font sables et nuées …
Dans d’autres occasions, ils accumulent et projettent
la foudre !... […]
« O mon corps, qui me rappelez à tout moment
ce tempérament mes tendances, cet équilibre
de vos organes, ces justes proportions de vos parties,
qui vous font être et vous rétablir au sein
des choses mouvantes ; prenez garde à mon ouvrage
; enseignez moi sourdement les exigences de la nature,
et me communiquez ce grand art dont vous êtes doué,
comme vous en êtes fait, de survivre aux saisons
et de vous reprendre des hasards. Donnez-moi de trouver
dans votre alliance le sentiment des choses vraies ; modérez,
renforcez, assurez mes pensées. Tout périssable
que êtes, vous l’êtes bien moins que
mes songes. Vous durez un peu plus qu’une fantaisie
; vous payez pour mes actes, et vous expiez pour mes erreurs
: instrument vivant de la vie, vous êtes à
chacun de nous l’unique objet qui se compare à
l’univers. La sphère tout entière
vous a toujours pour centre ; ô chose réciproque
de l’attention de tout le ciel étoilé
! Vous êtes bien la mesure du monde, dont mon âme
ne me présente que le dehors. |
|
| |
|
|